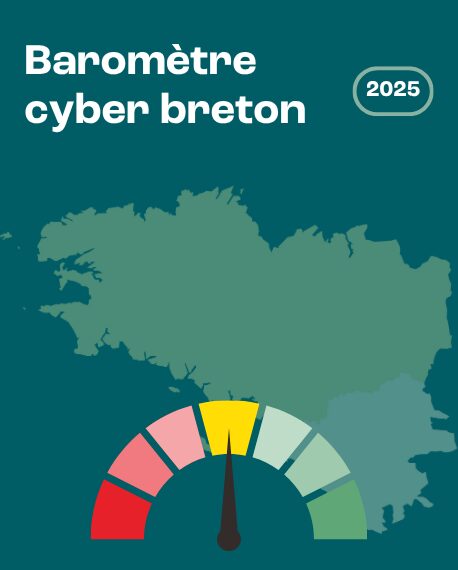Benjamin Morin, successeur de Florent Kirchner en tant que coordinateur de la stratégie nationale de cybersécurité pour le plan France 2030, a été invité au Cyber Breakfast du 29 août pour présenter les grandes lignes de cette feuille de route. Dans cet entretien, Benjamin Morin revient sur les cinq piliers de la stratégie, les évolutions par rapport à la précédente, et sur le rôle clé des acteurs régionaux, notamment à travers le campus cyber breton.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à la précédente stratégie nationale ?
Il n’y a pas de rupture franche entre les deux stratégies. Plusieurs mesures qui composent la nouvelle stratégie s’inscrivent dans la continuité d’actions qui ont été engagées dans le cadre de la stratégie précédente (ce qui témoigne de la clairvoyance celle-ci). Les évolutions entre les stratégies résident donc moins dans l’identification de nouveaux défis, que dans la hiérarchisation ou le progrès des mesures proposées pour les relever.
Quelques exemples :
- La formation, déjà présente dans la précédente stratégie, reste centrale mais nécessite désormais une rationalisation de l’offre, afin notamment de détecter des thématiques insuffisamment développées.
- La résilience cyber de la nation, moins prégnante dans la stratégie précédente, prend aujourd’hui une importance majeure avec l’entrée en vigueur de la directive NIS2 et les mutations du contexte géopolitique.
- La souveraineté numérique suppose la maîtrise de nos fondements et de nos dépendances numériques, et reste un enjeu majeur. Cette maîtrise passe en particulier par la poursuite des investissements de l’Etat dans le développement de technologies innovantes dans plusieurs domaines clés de la cybersécurité, et le soutien de filières d’excellence telles que l’évaluation de sécurité. Cette maîtrise passe également par la consolidation de champions au niveau Européen et à l’international.
- Des défis tels que la mise en œuvre du CRA ou la migration vers la cryptographie post-quantique, figurent maintenant parmi les enjeux majeurs de la stratégie nationale, même si ces enjeux ont déjà fait l’objet de mesures dans le cadre de la stratégie d’accélération cybersécurité de France 2030, depuis 2021.
- La nouvelle stratégie tient compte des progrès fulgurants de l’intelligence artificielle et de ses implications dans le domaine de la cybersécurité, qu’il s’agisse de la sécurité de, par ou face à l’IA.
- Enfin, le contexte géopolitique, en forte mutation depuis 2018, oblige à renforcer les réflexions autour de l’autonomie stratégique et de la souveraineté numérique.
La place des acteurs privés dans la stratégie nationale
Vous avez évoqué le rôle des acteurs privés dans l’élaboration de cette stratégie. Pouvez-vous préciser ?
Une nation forte en cybersécurité repose sur des acteurs industriels forts. La stratégie nationale de cybersécurité fixe la vision et les grandes orientations de l’État, mais les contributions de l’ensemble de l’écosystème cyber national, notamment de la filière industrielle, sont indispensables pour construire une stratégie partagée, solide. C’est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs aux retours, avis et idées constructives des acteurs du secteur.
La nouvelle stratégie nationale de cybersécurité donnera lieu à des adaptations des mesures qui composent la stratégie d’accélération cybersécurité du plan France 2030, qui avait été construite sur la base des recommandations de la revue stratégique de cyberdéfense de 2018, et des contributions de l’écosystème (industrie, académie, état, comité de filière).
Le rôle des campus cyber territoriaux
Quelle place pour les campus cyber territoriaux dans ce dispositif ?
Le campus cyber avait été pensé dans la précédente stratégie comme un lieu totem, réunissant acteurs industriels, académiques et institutionnels. Depuis, il s’est décliné en régions, ce qui est une excellente chose.
- Leur rôle est de fédérer l’écosystème, de relayer les orientations de la stratégie, mais aussi de faire remonter les besoins et propositions du terrain.
- Ils contribuent également à consolider l’offre nationale, encore trop fragmentée face aux grands acteurs extra-européens.
- Enfin, ils jouent un rôle central dans la formation, en cartographiant et rationalisant l’offre existante afin d’identifier les lacunes et doublons.
Aujourd’hui, il faut aller plus loin, et faire en sorte que les campus apportent de la valeur à leurs membres. C’est l’ambition que porte Joffrey Célestin-Urbain, le nouveau président du Campus Cyber national, et je la partage.
La Bretagne a inauguré son campus cyber il y a un peu plus d’un an. Comment se positionne-t-il dans cette dynamique ?
L’atout principal de la Bretagne, c’est la richesse de son écosystème cyber. Rennes, et plus largement le territoire régional, concentre une activité particulièrement dense : startups, grands groupes, acteurs de recherche et de formation.
Le campus cyber breton a donc tout son sens. Il permet de fédérer ces acteurs, de renforcer leur coordination et de donner une déclinaison territoriale concrète à la stratégie nationale. La proximité géographique est un vrai facteur de succès : je suis convaincu des vertus de l’ancrage local pour favoriser les synergies.
Publié le 15 octobre 2025 par ANDRE Guillaume
Nos autres articles
Dernières actualités et moments forts
du campus cyber breton sont ici !
Besoin d’aide ou de conseils sur le sujet ?
L’équipe de Bretagne Cyber Alliance est là pour vous orienter vers le meilleur interlocuteur de l'écosystème !